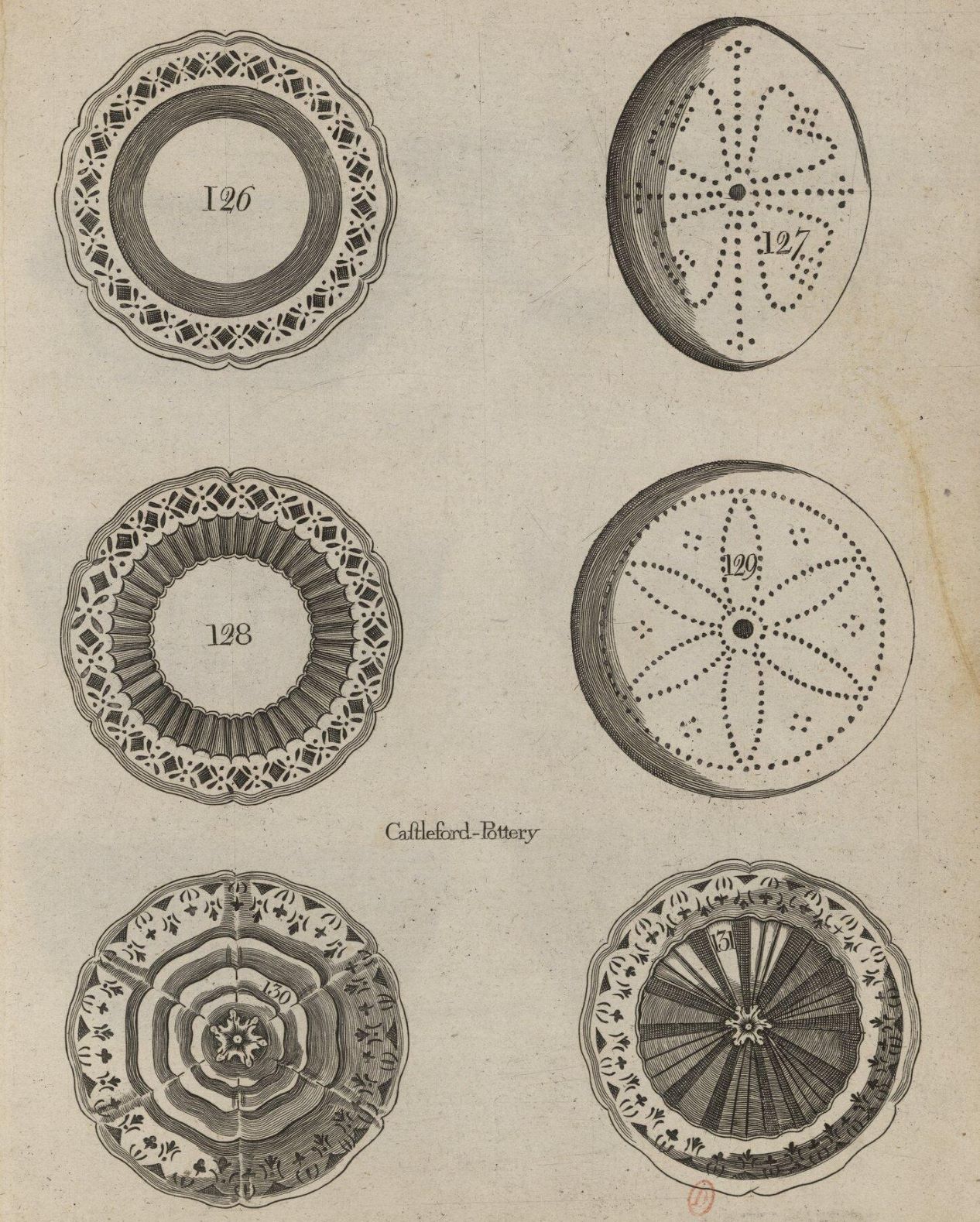Informations sur l’INHA, ses actualités, les domaines et projets de recherche, l’offre de services et les publications de l’INHA.

Rencontre avec Zoé Marty, professionnelle des musées territoriaux invitée à l’INHA
Mis à jour le 30 octobre 2025
Paroles
Zoé MARTY est conservatrice responsable des collections du musée d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole. Dans le cadre de la résidence des professionnels des musées territoriaux de l’INHA, elle a pu effectuer pendant trois mois des recherches pour la création d’un parcours permanent.
Vous, en quelques mots ?
Je m’appelle Zoé Marty. Je suis conservatrice au Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole.
Que faites-vous à l’Institut national d’histoire de l’art ?
Je suis à l’INHA dans le cadre d’une résidence qui propose aux conservateurs territoriaux du patrimoine de venir faire des semaines de recherche pendant une durée continue de 2 à 3 mois. Je travaille à la constitution d’un parcours permanent au sein du musée. Un parcours que l’on n’a pas actuellement. On a envie d’apporter un regard sur la création qui soit porteur des nouvelles recherches et nouvelles tendances autour de l’histoire de l’art. J’ai donc une recherche qui est multi-artistes. L’accès aux monographies, ici dans le magasin central, est assez essentiel. Il y a une facilité, notamment dans le magasin, d’accessibilité à la recherche et de pouvoir travailler par rebond, que l’on trouve difficilement ailleurs.
Comment votre sujet de recherche peut-il contribuer à notre compréhension de la société contemporaine ?
On a plein d’attitudes possibles dans les musées. On peut rêver, on peut se délecter, on peut se rencontrer, discuter. Dans une exposition temporaire on a tendance à suivre un fil, un discours assez serré sur une figure, sur un thème. Donc je trouve cela assez important de pouvoir créer un lieu où on a plus de liberté par rapport aux œuvres et par rapport à l’espace. On traite des œuvres du XVe siècle jusqu’à nos jours et je trouve cela assez intéressant parce que finalement on est aussi un reflet de la société. Est-ce qu’on est un musée d’art ou un musée de société ? On est un peu les deux. Je pense qu’il y a un réel besoin de médiation autour de l’art contemporain et créer des lieux qui puissent permettre ce dialogue-là, cela me semble assez essentiel.
Un objet, une image, une personnalité qui vous inspire en tant que conservatrice du patrimoine ?
C’est un roman qui s’appelle Chroniques du Pays des Mères par Élisabeth Vonarburg en 1992 et dans lequel beaucoup des figures et des héroïnes prennent soin de la mémoire, c’est leur travail. Et elles découvrent un musée, elles ne savent pas ce que c’est, et elles ne veulent pas conserver le musée parce que le musée, pour elles, il est représentatif du temps passé. Mais pour autant, les objets qui sont dans les musées, elles veulent les conserver mais à leur manière. Donc elles vont créer une nouvelle manière de prendre soin des objets en les diffusant et en les échangeant. Et je trouve cela assez intéressant. Le musée est un espace et une institution qu’on critique beaucoup aujourd’hui et trouver d’autres moyens, notamment à travers la fiction, de le penser pour le reconstruire me semble assez essentiel et c’est vrai que je n’arrive pas encore à l’incorporer tout à fait dans mes pratiques. C’est pour cela que ce roman m’inspire.
Un souvenir marquant face à l’art ?
Une artiste qui s’appelle Jeanne Gérardin et qui faisait de très beaux enroulements de tissus qui sont comme des escargots, avec des soies, des jeans. Cela m’a beaucoup fascinée, donc aujourd’hui ce sont des œuvres sur lesquelles je fais des recherches pour pouvoir les exposer l’année prochaine. Ce qui me motive quand je vois les objets, ce sont les points d’interrogation. C’est-à-dire trouver un objet qui vous rend curieux. Tout ce qu’on raconte après, comment un objet peut ouvrir un champ total, j’aime bien ça. Mais je n’ai pas de syndrome de Stendhal à raconter.
Voir cet entretien en vidéo
Paroles : rencontre avec Zoé Marty, professionnelle des musées territoriaux invitée à l’INHA